 Elle est la première femme à diriger un orchestre à la fin de la Première Guerre Mondiale et a obtenu le Concours du Prix de Rome.
Elle est la première femme à diriger un orchestre à la fin de la Première Guerre Mondiale et a obtenu le Concours du Prix de Rome. Marguerite Canal (1890-1978) naît à Toulouse en 1890. Son père est ingénieur et violoncelliste amateur, sa mère est pianiste et son frère est violoniste. Son père supervise sa formation musicale et développe sa culture littéraire, notamment son goût pour la poésie. Elle entre au Conservatoire de Paris à onze ans. Elle remporte le premier prix de fugue en 1915 et sera aussi récompensée en orgue en 1916. On lui suggère une carrière de chanteuse mais la passion pour la composition l’emporte. Elle s’était présentée dès 1914 au concours du Prix de Rome de composition, sans succès. Elle perd cette année-là son frère, tué dans les combats. Elle se représente en 1919, année où elle est nommée professeure de solfège au Conservatoire, et obtient un Premier Second Prix. Elle remporte en 1920 le Premier Prix, devenant la seconde femme après Lili Boulanger à recevoir cette distinction.
Marguerite Canal (1890-1978) naît à Toulouse en 1890. Son père est ingénieur et violoncelliste amateur, sa mère est pianiste et son frère est violoniste. Son père supervise sa formation musicale et développe sa culture littéraire, notamment son goût pour la poésie. Elle entre au Conservatoire de Paris à onze ans. Elle remporte le premier prix de fugue en 1915 et sera aussi récompensée en orgue en 1916. On lui suggère une carrière de chanteuse mais la passion pour la composition l’emporte. Elle s’était présentée dès 1914 au concours du Prix de Rome de composition, sans succès. Elle perd cette année-là son frère, tué dans les combats. Elle se représente en 1919, année où elle est nommée professeure de solfège au Conservatoire, et obtient un Premier Second Prix. Elle remporte en 1920 le Premier Prix, devenant la seconde femme après Lili Boulanger à recevoir cette distinction. 
 Marguerite Canal (1890-1978)
Marguerite Canal (1890-1978)  Marguerite Canal est née à Toulouse le 29 janvier 1890, et s’est éteinte près de cette même ville le 27 janvier 1978. Sa mère était une remarquable pianiste ; son père, ingénieur, aimait passionnément la musique. C’est lui qui supervisa les études musicales de sa fille ; il eut une influence décisive sur sa culture littéraire, lui faisant découvrir les œuvres des grands poètes, contrbuant ainsi à faire plus tard de Marguerite Canal une grande mélodiste. Au Conservatoire de Paris, Marguerite Canal fit de brillantes études, couronnées des plus hautes récompenses. En 1920, elle obtint le 1er Grand Prix de Rome, par un vote unanime, avec une scène dramatique, Don Juan, qui lui valut les félicitations personnelles de Saint Saëns. Dès 1919, Marguerite Canal avait été nommée professeur de solfège.
Marguerite Canal est née à Toulouse le 29 janvier 1890, et s’est éteinte près de cette même ville le 27 janvier 1978. Sa mère était une remarquable pianiste ; son père, ingénieur, aimait passionnément la musique. C’est lui qui supervisa les études musicales de sa fille ; il eut une influence décisive sur sa culture littéraire, lui faisant découvrir les œuvres des grands poètes, contrbuant ainsi à faire plus tard de Marguerite Canal une grande mélodiste. Au Conservatoire de Paris, Marguerite Canal fit de brillantes études, couronnées des plus hautes récompenses. En 1920, elle obtint le 1er Grand Prix de Rome, par un vote unanime, avec une scène dramatique, Don Juan, qui lui valut les félicitations personnelles de Saint Saëns. Dès 1919, Marguerite Canal avait été nommée professeur de solfège.
Chanteurs au Conservatoire, poste qu’elle quitta pour son séjour à Rome et ne reprit qu’en 1932. Elle avait été en 1917, la première femme en France à diriger un orchestre. La carrière de chant avait été suggérée à Marguerite Canal, mais la composition était sa vraie vocation. Elle travailla beaucoup avec Ninon Vallin, avec qui elle donna de nombreux récitals. Pianiste au toucher extraordinaire elle accompagna souvent ses propres œuvres, obtenant de ses interprètes vocaux le meilleur d’eux-mêmes. Le caractère et la personnalité de Marguerite Canal expliquent en partie l’oubli dans lequel est tombé son œuvre. Nature hyper sensible, Marguerite Canal connut tout au long de son existence une succession d’épreuves dont les plus cruelles furent la mort de son frère, tué au combat en 1914, et l’échec de son mariage. Elle avait une passion : les enfants. 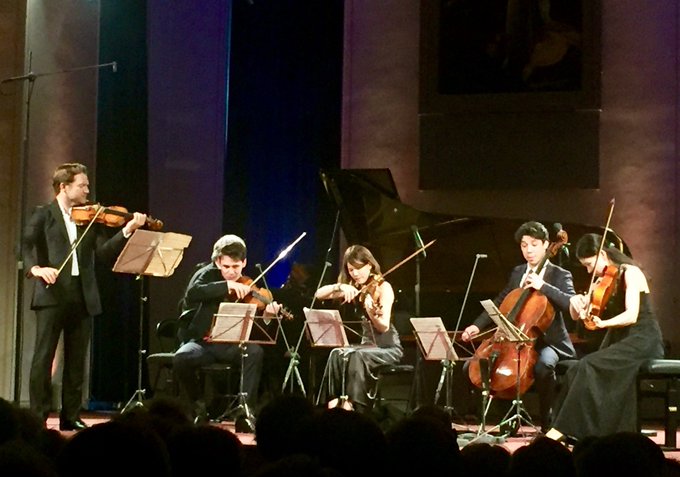
Canal, Marguerite (1890-1978) Compositeur et pédagogue français, qui fut la première femme en France à diriger des concerts d’orchestre. Né à Toulouse, France, le 29 janvier 1890 ; décédé à Cépet, France, le 27 janvier 1978 ; épousa Maxime Jamin. Née dans une famille de musiciens toulousains en 1890, Marguerite Canal révèle sa musicalité dès ses premières années et commence ses études au Conservatoire de Paris en 1903. Sous la direction de Paul Vidal, Canal se révèle une élève exceptionnelle, obtenant des premiers prix d’harmonie. , accompagnement au piano et fugue.  Attirée par la composition, elle commence à écrire des chansons, dont certaines pour accompagner ses propres poèmes. Ses talents phénoménaux sont reconnus en 1917 et 1918 lorsqu’elle devient la première femme à diriger des concerts d’orchestre en France (lors d’une série organisée au Palais de Glace). En 1919, elle est nommée professeur de solfège (solfège) pour chanteurs au Conservatoire de Paris, et l’année suivante, elle remporte le Premier Grand Prix de Rome pour sa scène dramatique pour voix et orchestre, « Don Juan ».
Attirée par la composition, elle commence à écrire des chansons, dont certaines pour accompagner ses propres poèmes. Ses talents phénoménaux sont reconnus en 1917 et 1918 lorsqu’elle devient la première femme à diriger des concerts d’orchestre en France (lors d’une série organisée au Palais de Glace). En 1919, elle est nommée professeur de solfège (solfège) pour chanteurs au Conservatoire de Paris, et l’année suivante, elle remporte le Premier Grand Prix de Rome pour sa scène dramatique pour voix et orchestre, « Don Juan ».
Au début des années 1920, la plupart des observateurs de la scène musicale française prédisaient un avenir significatif en tant que compositeur à Marguerite Canal. Au cours de ces années, elle épouse Maxime Jamin, qui devient l’éditeur de plusieurs de ses compositions les plus importantes. L’une de ses œuvres les plus émouvantes de cette phase productive est la Sonate pour violon et piano de 1922, qui s’inscrit dans la grande tradition lyrique de Franck et Fauré. De nombreux critiques ont estimé que cette pièce touchante était très probablement une évocation autobiographique de la vie affective d’une jeune femme. Spleen est une autre œuvre de musique de chambre qui a suscité des commentaires critiques très favorables une composition de 1926 pour violoncelle et petit ensemble. Un grand nombre des chansons les plus importantes de Canal ont été écrites à cette époque, dont beaucoup d’une grande beauté et d’une grande sensibilité, et sur certaines des meilleures œuvres de la poésie française, dont Baudelaire et Verlaine. L’une de ses œuvres vocales les plus délicatement travaillées est le cycle de mélodies, Amours tristes, sur ses propres vers et ceux d’autres poètes.
Bien que ses responsabilités d’enseignante l’aient occupée, Canal a pu, au début des années 1920, faire des progrès considérables vers l’achèvement de son projet le plus ambitieux à ce jour, un opéra à grande échelle. D’après une histoire de Jack London, Tlass Atka (Le pays blanc) était une œuvre ambitieuse, mais malheureusement la pression de ses responsabilités d’enseignante et ses bouleversements personnels (elle devait finalement divorcer de son mari Maxime Jamin) ont précipité une crise artistique qui a conduit à un rendement très diminué. Un certain nombre d’œuvres à moitié achevées, dont un Requiem, n’ont pas été finalisées et restent inédites. Elle a continué à composer dans les années 1940, mais il était clair que Canal avait pris la décision de se concentrer sur l’enseignement.
Les compositions de Marguerite Canal sont sensibles et souvent poignantes. Ses chansons, notamment celles sur des vers de Paul Fort, témoignent de son amour de la mer et des côtes bretonnes. D’autres, dont une mise en musique de 1948 de quatre berceuses dérivées de la poésie de Marceline Desbordes-Valmore, témoignent de son amour passionné des enfants, et sont un commentaire sur l’une des grandes tristesses de sa vie, n’avoir jamais eu d’enfant. Largement méconnus même des connaisseurs de la musique française moderne, les efforts créatifs de Marguerite Canal représentent un trésor esthétique encore à découvrir pour les mélomanes. Elle meurt à Cépet, près de sa ville natale de Toulouse, le 27 janvier 1978.
Œuvres référencées 
[Instrumental (solo)]
Arabesque – piano – 1921
Pages enfantines – Sept pièces faciles pour les commerçants – piano – 1931
Trois Pièces romantiques – piano – 1931
[Musique de chambre (max. 9 instruments)]
Idylle, opus 20 – violon, piano
Idylle – violoncelle, piano
Lied – violon, piano
Lied – violoncelle, piano
Près du moulin – violon, piano – 1924
Sonate – violon, piano
Spleen – violoncelle solo, quintette avec piano – 1924
Thème et Variations pour hautbois et piano – 1936
Élévation – violon, piano
[Musique vocale]
Amour partout – mélodie – 1948
Annie – mélodie – 1913
Berceuse pour Félice – mélodie – 1923
Bien loin d’ici – mélodie – 1940
Chanson de route – mélodie – 1931
Chanson pour Nanny – mélodie transcrite petit orchestre, piano conducteur obligé – 1924
Chanson à l’aube – mélodie – 1947
Chansons pour Michel et Miquette – mélodie – 1939
Don Juan – cantate, scène dramatique – 1920
Fugue – Chœur – concours de Rome 1914, chœur SATB, orchestre, orgue – 1914
Fugue – Chœur – concours de Rome 1919, chœur SATB, orchestre, orgue – 1919
Inscription sur un tombeau de la montagne Fou-Kipu – mélodie – 1922
J’ai pénétré, ô mon épouse… – mélodie – 1928
J’ai rêvé d’un jardin primitif… – mélodie – 1921
J’ai rêvé d’un port… – mélodie – 1939
Jane – mélodie – 1920
Je ne sais pourquoi – mélodie – 1931
Je sais des airs anciens – mélodie – 1915
Je suis venu calme orphelin – mélodie – 1931
L’Espoir luit comme un brin de poulle – mélodie – 1931
L’Image – mélodie – 1931
La Chanson du rouet – mélodie – 1908
La Femme au Miroir – mélodie – 1922
La Promenade attristée – mélodie – 1922
La Tête de Kenwarc’h – Poème barbare – cantate, voix, orchestre – 1915
Largue la voile – mélodie – 1938
Le Bonheur est dans le pré – mélodie – 1912
Le Miroir – mélodie – 1920
Le Miroir – mélodie transcrite petit orchestre, piano conducteur obligé – 1924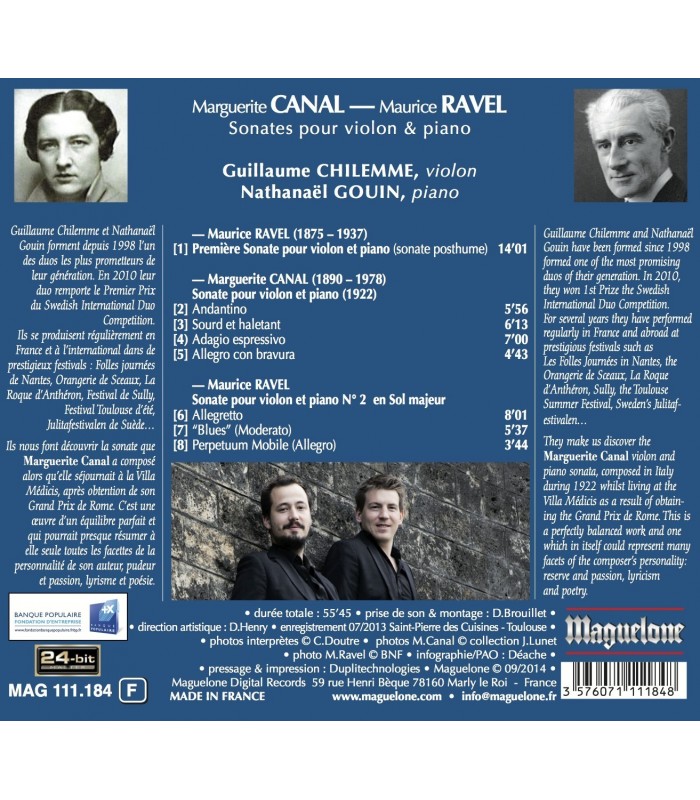 Le Petit Cimetière – mélodie – 1937
Le Petit Cimetière – mélodie – 1937
Le Regard éternel – mélodie voix moyenne, piano – 1947
Le Son du cor s’afflige vers les bois – mélodie – 1931
Lentement, doucement… – mélodie – 1921
Les Roses de Saadi – mélodie – 1923
Les Trois Princesses – mélodie – 1922
Les gondoles sont là – mélodie – 1921
Ma Maison d’Enfance – mélodie – 1939
Ma petite fille est si blonde – mélodie – 1937
Madrigal triste – mélodie – 1940
Mon âme est une infante – mélodie – 1921
Mon épousée, ma sœur – mélodie – 1928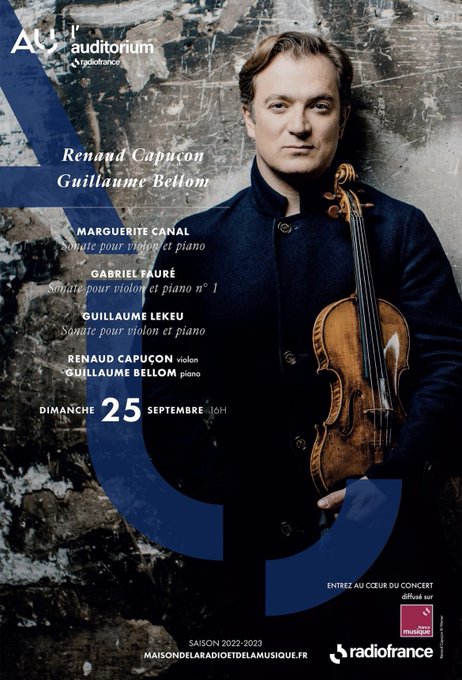
Myro – mélodie – 1919
Nanny – mélodie – 1915
Narcisses – mélodie – 1922
Nell – mélodie – 1916
Pluie de printemps – mélodie – 1922
Prière – mélodie – 1930
Qu’il est exquis, ton amour – mélodie – 1928
Recueillement – mélodie
Romance – mélodie
Sous l’vent du nord – mélodie
Un grand sommeil noir – mélodie – 1919
Voeu – mélodie – 1922
Vous m’avez dit, un soir – mélodie – 1939
Vous m’avez trahie – mélodie – 1939
Vous me disiez aussi – mélodie – 1939
Vous ne voulez pas voir – mélodie – 1939
Vous voilà, vous voilà – mélodie – 1931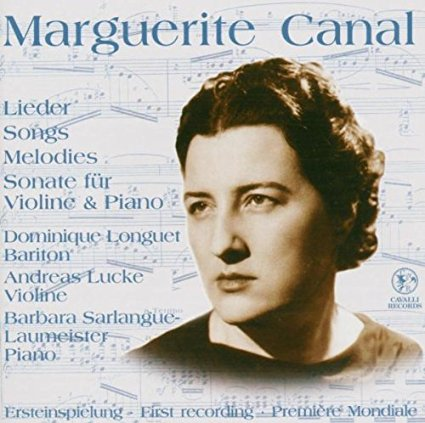
[Orchestre]
Arabesque – transcription orchestre – 1924
La Tête de Kenwarc’h – Poème barbare – cantate, orchestre avec piano conducteur – 1924
[Orchestre avec soliste(s)]
Spleen – violoncelle solo, quintette avec piano – 1924
Femmes dans l’histoire – Marguerite Canal (1890-1978)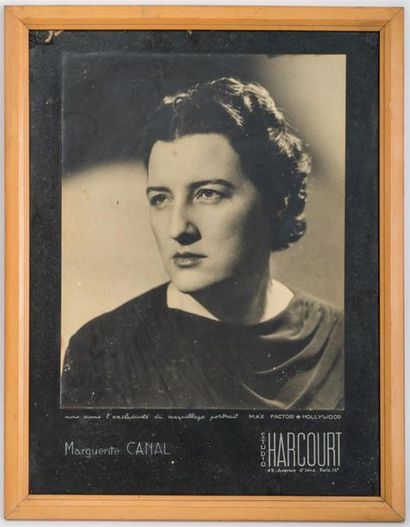
Marie-Marguerite-Denise Canal (29 janvier 1890 – 27 janvier 1978) était une chef d’orchestre, professeur de musique et compositrice française. Née à Toulouse dans une famille de musiciens, son père l’initie à la musique et à la poésie. Elle étudie au Conservatoire de Paris en 1911, et après avoir terminé ses études, devient professeur au Conservatoire en 1919. En 1917, elle devient la première femme en France à diriger un orchestre, et remporte le Prix de Rome en 1920 avec Don Juan. Elle est décédée à Cépet, près de Toulouse.
https://www.presencecompositrices.com/compositrice/canal-marguerite/